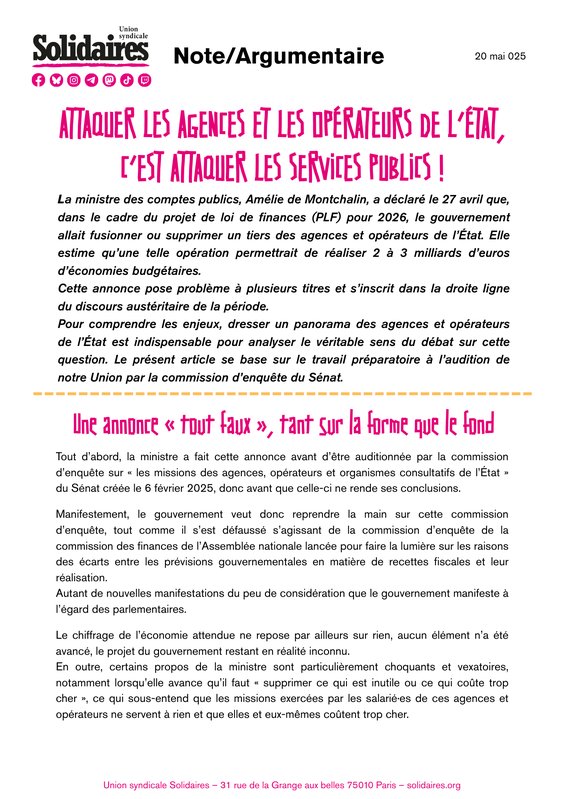La ministre des comptes publics, Amélie de Montchalin, a déclaré le 27 avril que, dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le gouvernement allait fusionner ou supprimer un tiers des agences et opérateurs de l’État. Elle estime qu’une telle opération permettrait de réaliser 2 à 3 milliards d’euros d’économies budgétaires. Cette annonce pose problème à plusieurs titres et s’inscrit dans la droite ligne du discours austéritaire de la période.
Pour comprendre les enjeux, dresser un panorama des agences et opérateurs de l’État est indispensable pour analyser le véritable sens du débat sur cette question. Le présent article se base sur le travail préparatoire à l’audition de notre Union par la commission d’enquête du Sénat.
Une annonce « tout faux », tant sur la forme que le fond
Tout d’abord, la ministre a fait cette annonce avant d’être auditionnée par la commission d’enquête sur « les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État » du Sénat créée le 6 février 2025, donc avant que celle-ci ne rende ses conclusions. Manifestement, le gouvernement veut donc reprendre la main sur cette commission d’enquête, tout comme il s’est défaussé s’agissant de la commission d’enquête de la commission des finances de l’Assemblée nationale lancée pour faire la lumière sur les raisons des écarts entre les prévisions gouvernementales en matière de recettes fiscales et leur réalisation. Autant de nouvelles manifestations du peu de considération que le gouvernement manifeste à l’égard des parlementaires.
Le chiffrage de l’économie attendue ne repose par ailleurs sur rien, aucun élément n’a été avancé, le projet du gouvernement restant en réalité inconnu. En outre, certains propos de la ministre sont particulièrement choquants et vexatoires, notamment lorsqu’elle avance qu’il faut « supprimer ce qui est inutile ou ce qui coûte trop cher », ce qui sous-entend que les missions exercées par les salarié·es de ces agences et opérateurs ne servent à rien et que elles et eux-mêmes coûtent trop cher.
Bref panorama des agences et opérateurs
Selon le rapport, dit « jaune budgétaire », consacré aux opérateurs de l’État et annexé au PLF, « Au PLF 2025, sont inscrits 434 opérateurs de l’État rémunérant 402 218 emplois sous plafond (en équivalents temps plein travaillés) et bénéficiant de 77 Mds d’euros de financement publics ».
Les missions de ces entités sont très variées et utiles : Pôle emploi, Météo France, le CNRS ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ou l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Selon le gouvernement lui même (rapport jaune budgétaire sur les opérateurs de l’État ; « Les opérateurs de l’État jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques conduites par le Gouvernement et leur pilotage revêt ainsi une dimension stratégique importante »).
S’agissant des moyens budgétaires, il existe un plafonnement des taxes qui leur sont affectées ainsi que des moyens en emplois, ce qui tend à démontrer que d’éventuelles économies à dégager par la réduction du nombre de ces entités seraient bien faibles, sans à vouloir privatiser leurs missions, ce qui transférerait le coût public vers le coût privé tout en changeant la nature de leurs missions.
Dans le détail, la moitié des opérateurs compte moins de 250 salarié·es, 17 % en comptent moins de 50 (ce qui rend presque impossible la réalisation d'économies d’échelle) et cinq opérateurs ou catégories d’opérateurs concentraient plus de 60 % des emplois sous plafond : les universités et assimilés (un tiers des effectifs environ), France Travail, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Commissariat à l’énergie atomique et le réseau des œuvres universitaires et scolaires.
Il a été établi que les 3 principaux centres de recherches emploient la moitié des opérateurs : le (CNRS), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et l’Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (INRAE). À l’inverse, neuf opérateurs ne comptent aucun emploi. Il est donc difficilement imaginable de réaliser des économies sur ces dépenses. Deux raisons l’expliquent ; d’une part, ce sont des dépenses stratégiques et d’avenir et d’autre part, les marges de manœuvre sont faibles.
Quel est le vrai débat sur ces entités ?
Le gouvernement et les parlementaires de droite qui ont posé la question des agences et des opérateurs ont biaisé le débat. Leur objectif est avant tout de réduire et d’affaiblir l’action publique dans son ensemble en maniant l’austérité budgétaire sur fond de dramatisation de la question de la dette publique et de refus obstiné de procéder à une réforme fiscale visant à mettre davantage à contribution les plus riches et les grandes entreprises.
L’Union syndicale Solidaires n’est a priori pas partisane d’une organisation de l’action publique par des agences (terme fortement connoté et inspiré des politiques néolibérales) et par des opérateurs potentiellement trop éloignés du cœur de l’action publique. Pour autant, nous nous inquiétons des éventuelles conclusions et perception dans l’opinion de travaux et d’expressions dont les objectifs seraient surtout tournés vers la réduction du périmètre de l’action publique. Précisons par ailleurs que, contrairement à ce que les pourfendeurs de ces entités laissent entendre, leur nombre baisse progressivement. Il est ainsi déjà passé de 649 en 2008 à 434 actuellement1.
En réalité, le véritable débat devrait porter sur le périmètre pour l’action publique et, par conséquent, des moyens à lui allouer. De manière générale, en matière d’action publique, la priorité devrait être de la consolider et de renforcer tant le périmètre que ses moyens.
Dans le cadre d’un tel débat, on peut poser sereinement la question de maintenir certaines entités en raison de leur spécificité ou, pour d’autres, de revenir à une organisation des politiques publiques sans ce type d’opérateurs (ceci supposerait alors de réinternaliser les entités concernées d’une certaine manière dans les services publics traditionnels).
En tout état de cause, il faut éviter toute généralisation. Historiquement en effet, la décision de créer de telles entités a été basée sur la spécificité de leurs missions et/ou sur la nécessaire distance à avoir par rapport au pouvoir politique (la CNIl par exemple), sans pour autant privatiser la mission. Tout ceci pouvait par exemple justifier le besoin d’une certaine diversité dans le recrutement (régulation des télécoms) voire la gestion des personnels, même s’il est vrai que la loi de 2019 a hélas largement ouvert le recrutement aux contractuel·les dans la fonction publique.
Dans le cadre d’un tel débat enfin, il serait possible d’établir une définition juridiquement solide et une réflexion sur une « harmonisation » (base juridique, détermination du périmètre, etc) de ces entités.
Défendre l’action publique contre toutes les attaques
Plusieurs exemples montrent que, finalement, certains opérateurs importants se sont avérés utiles et efficaces. Qu’il s’agisse du domaine scientifique et de l’énergie, de la concurrence, de l’autorité des marchés financiers, de l’office national des forêts ou encore de la commission nationale informatique et libertés par exemple, l’utilité et la spécificité de ces opérateurs a été largement démontrée.
Les supprimer risquerait de mettre l’efficacité de leurs missions en danger. Si une analyse au cas par cas des entités pourrait conduire à maintenir certaines de ses entités et, pour d’autres, à les faire évoluer pour les réintégrer davantage le giron des administrations, la priorité est de défendre le périmètre de l’action publique et, par conséquent, de s’opposer à tout baisse de ses moyens financiers et humains.
Pour l’Union syndicale Solidaires, ce combat fait partie intégrante de notre combat pour les services publics. Au-delà du débat sur l’organisation de l’action publique, pour l’Union syndicale Solidaires, face aux attaques austéritaires d’une idéologie qui rêvent de privatiser les missions de service public, l’enjeu principal est d’ancrer toutes les missions d’intérêt général au sein de l’action publique, avec des moyens à la hauteur.
1 Le nombre d’opérateurs a diminué depuis le PLF pour 2008 (649 opérateurs) au PLF pour 2012 (560) puis celui pour 2020 (483). Depuis le PLF pour 2021, ce nombre est relativement stable (entre 430 et 440 opérateurs selon les années).